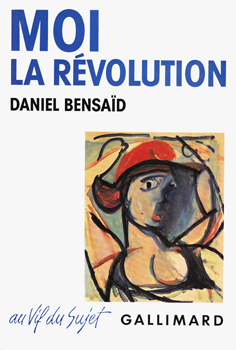Par Gérard Guégan
À rebours du conformisme dominant, qu’il se pare des plumes du paon (Furet), ou du tralala de l’autruche (Goude), Moi, la Révolution, de Daniel Bensaïd, commence comme une charge et finit comme un cantique. Toujours surprenant, jamais larmoyant. De sorte que, rapidement transporté, le lecteur acquiesce à tout et engloutit les paragraphes. Au point de regretter que ça se termine à la page 291.
Donc, dans un temps où, pour mieux « poncer, lisser, décolorer » (Bensaïd dixit) la Révolution, on s’apprête à la noyer sous le clinquant publicitaire, comme si elle n’était qu’un long fleuve tranquille, un professeur de philosophie – telle est l’occupation présente de Bensaïd – se cabre, s’entête et refuse de se laisser emporter par le flot lénifiant. Un flot qui prend sa source aussi bien aux escamotages des Furet et Ozouf, qui s’en vont répétant, histoire de se rassurer eux-mêmes, que la Révolution française est achevée, dans la stratégie consensuelle (quel mot !) d’un président que l’on prétend socialiste.
Car enfin, ce Bicentenaire, de quoi parle-t-il ? Ou plutôt, qui veut-il empêcher de parler ? Qui veut-il faire taire ? Sinon la voix de l’éternelle insubordination ? Et comment mieux y parvenir qu’en la travestissant, en la transformant en objet de mise en scène, alors quelle est, forcément, sujet ?
Aussi le coup de génie de Bensaïd est-il d’avoir retourné à son profit pareille situation. À son tour, il s’est glissé dans la peau du personnage, et a osé l’ouvrir là où tant de nouveaux courtisans la ferment.
Entre parenthèses, le rôle étant difficile à tenir, Bensaïd le joue parfois à contre-emploi, précisément quand à deux reprises, il définit sa conception de la fête, plus masculine que féminine. C’est Albertine – puisqu’il aime Proust –, mais à l’envers. Qu’importe, on sourit, et on revient à l’essentiel.
Qui est que, sous sa plume, la Révolution, que l’on voudrait étouffer, refait entendre son halètement fiévreux et ses mots de soufre. C’est un livre contre les habitudes, seraient-elles récentes, et pour les espérances, seraient-elles grandes. Moyennant quoi, les médiocres, qui se complaisent à la gestion des affaires et qui sentent mauvais de la conscience, en prennent un sale coup.
Ici, on n’appelle ni Camus, ni Aron à la rescousse, on ne confond pas Jeanne d’Arc avec Adjani, on cite à la barre Péguy, qui se rata parce que le réfractaire est souvent impatient, et le Godard du Mépris, son meilleur film bien sûr, puisque le seul explicitement contre la Valeur et pour les valeurs.
On y convoque aussi la mémoire, dont la perte accompagne la plupart du temps le reniement. Et puis, on remet en selle, pour un galop qui ne peut être ultime, les grands oubliés du spectacle, Marat, Saint-Just, les Enragés.
Mais, une fois encore, ce qui frappe, et séduit, c’est le ton de cette voix, sa couleur, allègre, et nullement métaphorique. En prise directe, comme il sied à l’insolence, avec le monde tel qu’il est.
Et que ce soit un trotskiste qui lui ait prêté son organe n’est pas pour nous gêner. Pour peu qu’on se refuse à courber la tête, nous sommes, tous, des enfants de Trotski. Même adultérins, même parricides.
Page 27, donc dès le début de son livre. Daniel Bensaïd écrit ceci, qui fera conclusion : « Ah ! vous avez voulu un Bicentenaire d’unanimité et de réconciliation ? Et si c’était tout le contraire ? Si ce n’était que le début d’un effondrement ? D’une mortelle fracture ? D’une incurable fissure ? Celle des grands mythes fondateurs de la République et de la Résistance ? »
Gérard Guégan
revue Passages, mai 1989